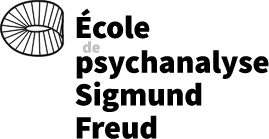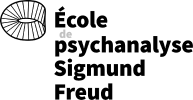« La clinique psychanalytique doit consister non seulement à interroger l’analyse, mais à interroger les analystes, afin qu’ils rendent compte de ce que leur pratique a de hasardeux, qui justifie Freud d’avoir existé. » (J. Lacan, « Ouverture de la section clinique », Ornicar ?, n° 9). Il s’agit par conséquent, pour chacun des analystes praticiens participant à un laboratoire, d’interroger, avec les autres, sa propre pratique de la cure là où elle se mesure chaque fois à la singularité de la clinique. Ni contrôle, ni exposé savant donc, mais une recherche dont le thème qui oriente chaque laboratoire permet un questionnement théorique.
L’inscription dans les laboratoires implique un réel engagement de chacun à témoigner de l’expérience des cures qu’il mène. Interroger sa pratique, tâcher d’en rendre compte, suppose de remettre en question les points théoriques sur lesquels chacun prend appui ou peut achopper. Ce travail commun peut questionner, singulièrement pour chacun, l’intransmissible de la psychanalyse.