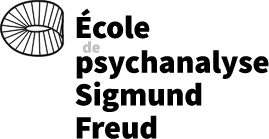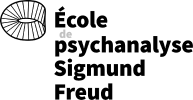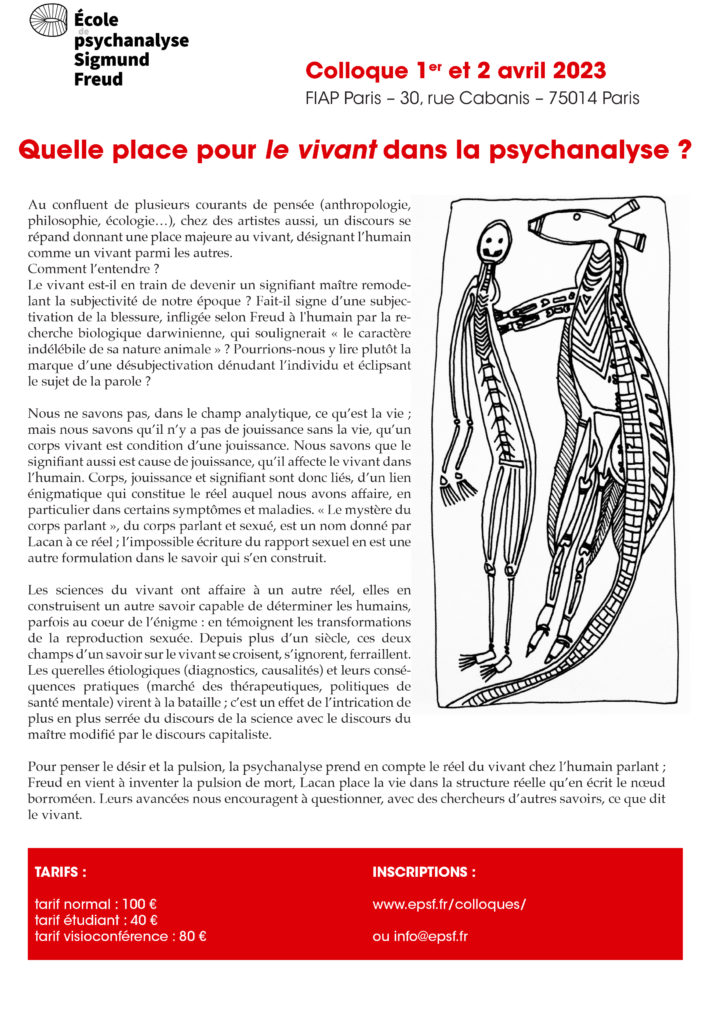Colloque 1er et 2 avril 2023
FIAP Paris, 30 rue Cabanis, 75014 Paris
Pour consulter le programme détaillé du colloque, cliquez [ici].
Au confluent de plusieurs courants de pensée (anthropologie, philosophie, écologie…), chez des artistes aussi, un discours se répand donnant une place majeure au vivant, désignant l’humain comme un vivant parmi les autres.
Comment l’entendre ?
Le vivant est-il en train de devenir un signifiant maître remodelant la subjectivité de notre époque ? Fait-il signe d’une subjectivation de la blessure, infligée selon Freud à l’humain par la recherche biologique darwinienne, qui soulignerait « le caractère indélébile de sa nature animale » ? Pourrions-nous y lire plutôt la marque d’une désubjectivation dénudant l’individu et éclipsant le sujet de la parole ?
Nous ne savons pas, dans le champ analytique, ce qu’est la vie ; mais nous savons qu’il n’y a pas de jouissance sans la vie, qu’un corps vivant est condition d’une jouissance. Nous savons que le signifiant aussi est cause de jouissance, qu’il affecte le vivant dans l’humain. Corps, jouissance et signifiant sont donc liés, d’un lien énigmatique qui constitue le réel auquel nous avons affaire, en particulier dans certains symptômes et maladies. «Le mystère du corps parlant », du corps parlant et sexué, est un nom donné par Lacan à ce réel ; l’impossible écriture du rapport sexuel en est une autre formulation dans le savoir qui s’en construit.
Les sciences du vivant ont affaire à un autre réel, elles en construisent un autre savoir capable de déterminer les humains, parfois au coeur de l’énigme : en témoignent les transformations de la reproduction sexuée. Depuis plus d’un siècle, ces deux champs d’un savoir sur le vivant se croisent, s’ignorent, ferraillent. Les querelles étiologiques (diagnostics, causalités) et leurs conséquences pratiques (marché des thérapeutiques, politiques de santé mentale) virent à la bataille ; c’est un effet de l’intrication de plus en plus serrée du discours de la science avec le discours du maître modifié par le discours capitaliste.
Pour penser le désir et la pulsion, la psychanalyse prend en compte le réel du vivant chez l’humain parlant ; Freud en vient à inventer la pulsion de mort, Lacan place la vie dans la structure réelle qu’en écrit le nœud borroméen. Leurs avancées nous encouragent à questionner, avec des chercheurs d’autres savoirs, ce que dit le vivant.
Textes préparatoires
Cartel colloque : Gérard Bailhache, Nils Gascuel, Cyril Saint-Marc, Marie-Jeanne Sala, Annie Tardits et Sylvain Gross (plus- un).
Nous assistons depuis quelques années à une « promotion » du signifiant vivant dans le discours social, scientifique, anthropologique, écologique. Il s’agit en anthropologie et dans le discours scientifique d’une véritable modification du paradigme classique nature/culture au profit d’humain/non humain et de la question nouvelle de la continuité/discontinuité du vivant ou des vivants entre eux.
Avec la pandémie virale et les discours qu’elle convoque dans le social (scientifiques, politiques), un biopouvoir a été dévoilé, avec d’un côté une alliance du discours de la science et du discours capitaliste, et d’un autre coté́ le malaise que provoque le non su (pas encore su) dans les sciences et la médecine. Étrange distribution du possible et de l’impossible entre exploits techniques et failles dans le savoir.
Déjà̀ bien avant – depuis une trentaine d’années – le vivant (les vivants) était devenu un signifiant majeur dans certains discours, neurobiologique, philosophique ou encore anthropologique, en résonance avec les alertes écologiques qui font état de la menace qui pèse sur le vivant.
1/ Questions actuelles
Il est apparu au cours de nos réflexions différents thèmes d’élaborations cliniques ou d’interrogations qui pouvaient concerner la psychanalyse sur ce thème complexe et vaste du « vivant ». Nous citerons ces questions éparses :
- Le savoir technique scientifique sur la physiologie hormonale et la fabrication synthétique de ces hormones par les laboratoires pharmaceutiques transforment chez les adolescents leur rapport à leur sexe.
On assiste ainsi aujourd’hui chez certains adolescents et parfois des enfants à des revendications identitaires sexuelles (genrées) qui peuvent les amener à transformer leur corps grâce à des traitements hormonaux et des opérations chirurgicales.
- Le lien entre mathématiques et biologie (existence à l’Institut Pasteur d’un centre de recherches sur la « modélisation des processus mutationnels »).
- Le mystère des maladies auto-immunes et de l’immunité en général
- Le paradoxe de l’apoptose et des cellules qui produisent une dévastation précisément parce qu’elles n’arrivent pas à mourir
- Les phénomènes dits psychosomatiques
- La captation de l’autisme par la neurobiologie (à lire a contrario : « Gaspard de la nuit » d’E. de Fontenay)
- L’apparition de nouveaux diagnostics comme « les troubles spécifiques des apprentissages » chez l’enfant, réduits à un groupe appelé : « troubles neurodéveloppementaux » tout comme d’ailleurs le trouble attentionnel avec déficit de l’attention et le trouble du spectre autistique et les troubles de la motricité.
C’est ainsi la réduction au développement cérébral et neurologique qui résume aujourd’hui toute la clinique de la psychiatrie de l’enfant. Les psychanalystes d’enfants étant régulièrement attaqués depuis plusieurs années s’agissant de la question de l’autisme et de la psychose de l’enfant.
- Avec la pandémie est apparu le recours au télétravail et aux téléconsultations, cela aura-t-il des effets sur les pratiques des psychanalystes, le dispositif de la cure sera-t-il touché par le recours aux technologies numériques ?
- Les questions de la maitrise technique scientifique de la reproduction s’agissant de la Procréation médicalement assistée. Les demandes de soins par exemple dans les CMPP ou en cabinet d’analyste de parents d’enfants issus de PMA.
- La détermination des diagnostics par la pharmacologie
- La question du déclenchement de maladies organiques pendant les cures ou à l’inverse de la sédation de symptômes organiques au cours d’une cure analytique.
- Le déni du sexuel infantile dans les discours médiatiques sur la pédophilie et l’inceste et son « retour » sur la scène médiatico-juridique.
- Les poètes et le vivant de la vie
Avec quelles élaborations de Freud et de Lacan nous repérer pour penser ces faits, ces discours, ce qu’ils « font » à l’analyse ? (Sans doute pas la même chose à Freud et à Lacan). Quels concepts mobiliser ? Qu’entendons-nous dans la clinique ?
Du côté de l’anthropologie, il s’est produit en 2005 un évènement de pensée. Philippe Descola a récusé le dualisme canonique nature/culture défendu par Claude Lévi-Strauss avec toute son autorité comme étant un fait universel, et lui a substitué un groupe de quatre ontologies distinctes, au sein duquel ce dualisme n’est plus qu’une formule parmi d’autres. En particulier le naturalisme occidental postule une discontinuité des intériorités et une continuité des physicalités, qui est l’inverse de l’animisme, pour lequel au contraire il y a une continuité des intériorités à travers le vivant et une discontinuité des mondes physiques. (Les deux autres systèmes étant le totémisme et l’analogie). Or, il se fait que l’animisme de certains peuples traditionnels converge avec une tendance actuelle à insister sur la continuité homme-animal, sur la solidarité et l’interdépendance de tous les êtres vivants. Cette tendance, très forte, est relayée dans le social par toutes sortes d’initiatives et de protestations. Et l’avancée de Descola consonne avec des idées de Bruno Latour ou d’Isabelle Stengers, de Jean-Baptiste Morizot, Emilie Hache, Despret, Tsing, Viveiros de Castro, Haraway…
On veut sortir du monde muet de Galilée, de Bacon et Descartes, réduit à des indications opératoires, on ne veut plus du mode capitaliste qui a défait toutes les interdépendances, ni d’une science qui ne sait définir qu’en isolant.
Selon « l’hypothèse Gaïa » de Lovelock et Margulis (1974) la Terre serait un grand organisme au fonctionnement symbiotique, régulant harmonieusement ses composantes. Ce monde plein, solidaire et continu, évacue la négativité́ telle que nous l’entendons : division, discordance, castration, manque, pulsion de mort… Lacan a toujours récusé l’idée d’une imbrication harmonieuse de l’Innenwelt et de l’Umwelt, chez von Uexküll par exemple, pionnier de l’écologie. Que fait donc ce tournant à la pensée de Lacan pour autant qu’elle est tributaire de Lévi-Strauss ?
2/ Le corps et les pulsions sexuelles
Freud semble vouloir faire surgir la pulsion du vivant, d’une « substance vivante » dont il se sert pour construire une hypothèse scientifique teinté de Lamarckisme (la transformation du vivant par le milieu). Ainsi par exemple dans cet extrait de « l’Au-delà du principe de plaisir » :
« Devons-nous à l’instar du philosophe-poète (Platon et le mythe d’Aristophane), risquer l’hypothèse que la substance vivante, au moment où elle prit vie, fut déchirée en petites particules, qui depuis lors aspirent à leur ré-union de par les pulsions sexuelles ? Que ces pulsions, dans lesquelles se poursuit l’affinité chimique de la matière non douée de vie, surmontent progressivement à travers le règne des protistes, les difficultés qu’opposent à cette tendance un environnement chargé de stimulis dangereux pour la vie, qui les oblige à la formation d’une couche corticale protectrice ? Que ces fragments dispersés de substance vivante atteignent ainsi à la pluricellularité et finissent par transférer aux cellules germinales, avec le maximum de concentration, la pulsion à la re-union ? Rompons-là, je crois que c’en est ici le moment. »[1]
En 1968, Lacan revenait dans « Les quatre concepts (…) » sur cette question des pulsions et du rapport au vivant traité par Freud dans « l’Au-delà du principe de plaisir » :
« Or ce dont il s’agit concernant la pulsion est-il du registre de l’organique ? Est-ce ainsi qu’il faut interpréter ce que dit Freud dans un texte qui fait partie de Jenseits des lustprinzips- que la pulsion, le Trieb représente die Aüsserung der Trägheit, quelque manifestation de l’inertie dans la vie organique ? Est-ce une notion simple, qui se complèterait de la référence à un arrimage de cette inertie que serait la fixation, la Fixierung ?
Non seulement je ne le pense pas mais je pense qu’un examen sérieux de l’élaboration que donne Freud de la notion de la pulsion va là contre. »[2]
Puis plus loin :
« Pour examiner ce qu’il en est du Trieb, Freud se réfère-t-il à quelque chose dont l’instance s’exerce au niveau de l’organisme dans sa totalité ? Dans son état d’ensemble, le Réel fait il ici irruption ? Est-ce le vivant qui est intéressé ici ? Non »[3]
« La constance de la poussée (de la pulsion) interdit toute assimilation de la pulsion à une fonction biologique, laquelle a toujours un rythme (…) c’est une force constante. »[4]
Lacan réinterroge cette question du lien entre pulsion et organique, inanimé, organisme et biologie pour semble-t-il démonter leurs liens de « parenté » instauré par la théorie freudienne.
Certains signifiants : organique, biologie, protistes, inanimés/animés, l’organisme/le corps, pulsions sexuelles émergent quand on essaie d’aborder la question de « qu’est-ce que la vie, le vivant ? » et Lacan confronte à nouveau jour (par exemple concernant la question des pulsions sexuelles) les concepts freudiens à ceux de la science. Dans le séminaire XI, il démontre que le concept de pulsion freudien n’a rien à voir avec un concept biologique.
Cette démarche nous éclaire sur ce que Lacan différencie comme réel de l’analyste et réel du scientifique.
Le réel auquel à affaire le psychanalyste est autre que celui auquel à affaire le Scientifique.
Lacan dans la « Lettre aux Italiens »[5] :
« Il faut pour cela (c’est d’où résulte que j’aie attendu pour la frayer), il faut pour cela du réel tenir compte. Soit de ce qui ressort de notre expérience du savoir : II y a du savoir dans le réel. Quoique celui-là, ce ne soit pas l’analyste, mais le scientifique qui a à le loger. L’analyste loge un autre savoir, à une autre place mais qui du savoir dans le réel doit tenir compte. Le scientifique produit le savoir, du semblant de s’en faire le sujet. Condition nécessaire mais pas suffisante. S’il ne séduit pas le maître en lui voilant que c’est là sa ruine, ce savoir restera enterré comme il le fut pendant vingt siècles où le scientifique se crut sujet, mais seulement de dissertation plus ou moins éloquente. Je ne reviens à ce trop connu que pour rappeler que l’analyse dépend de cela, mais que pour lui, de même, ça ne suffit pas. »
Ainsi Lacan se tiendra au fait des conceptualisations scientifiques de son temps en particulier pour traiter de la question du corps. Ce corps « appendice de la vie » de « tout être vivant ». Un corps qui à la fin de son enseignement est envisagé comme « corps-trique » nouant les trois registres du corps (RSI). Lacan place « la vie » dans le ce rond R du nœud borroméen.
En 1974, Lacan revient encore sur « l’Au-delà du principe de plaisir » et la question des rapports chez Freud entre l’inanimé et la mort, solidaire de la vie :
« Mais il y a quelque chose quand même qui fait un pli, pour ce qui est de FREUD, c’est l’instinct de mort. Bien sûr, moi j’ai fait un petit pas de plus que lui. Mais c’est dans le mauvais sens. Lui, tourne autour. Lui, lui se rend bien compte. Il faut que vous lisiez pour ça le fameux Au-delà̀ – oui… – Au-delà̀ du principe du plaisir, comme par hasard. Dans cet au-delà̀… il se tracasse comment quelque chose dont le module c’est de rester à un certain seuil : le moins de tension possible, c’est ça qui plait à la vie, qu’il dit. Seulement, il s’aperçoit dans la pratique que ça ne marche pas. Alors il pense que ça passe plus bas que le seuil. À savoir que cette vie qui maintient la tension à un certain seuil, elle se met tout d’un coup à lâcher, et que sous le seuil, la voilà qui succombe, qui succombe jusqu’à rejoindre la mort. C’est comme ça qu’à la fin du compte, il fait passer le machin. La vie c’est quelque chose qui s’est levé un jour, Dieu sait pourquoi, c’est le cas de le dire, et puis qui ne demande qu’à faire retour, comme tout le reste. Il confond le monde inanimé avec la mort. Il est inanimé, ça veut dire qu’il est supposé ne rien savoir. Ça ne veut rien dire de plus pour quiconque donne à l’âme son équivalent sensé. Mais ce fait qu’il ne sache rien, ça ne prouve pas qu’il est mort. Pourquoi le monde inanimé serait un monde mort ? Ça veut pas dire grand-chose, certes, mais poser la question a aussi bien son sens. Quoi qu’il en soit, corrélativement à cette question de l’Au-delà du principe du plaisir, FREUD nage dans ceci, qui est beaucoup plus près de la question de la mort, à savoir de ce que c’est. » [6]
3/ Le Sujet
Il s’agit aussi de savoir ce qu’on entend par le « sujet de la science ». Que veut-on dire au juste quand on affirme que la psychanalyse « opère sur le sujet de la science » ? D’une part il y a le sujet (le sujet du signifiant) ; d’autre part il y a chez Lacan le sujet de la science et le sujet de la religion, le sujet mythant, enfin il y a encore le sujet à venir de la psychanalyse : cela fait quatre. (Et peut-être davantage si l’on veut ajuster les deux du milieu au carré de Descola, avec ses hybrides et ses transitions).
Lacan ne confond jamais le sujet et l’individu, qui n’est plus guère, aux temps modernes, que le prolétaire réduit, comme dirait Marx, à ses nerfs, muscles et cerveau, c’est-à-dire à son corps biologique, dépouillé́ de son savoir.
Une figure du sujet serait donnée dans la parole poétique en tant qu’expression qui n’a rien à prouver ni à défendre. « Leben ist Tod, und Tod ist ein Leben », Hölderlin (traduction d’André́ du Bouchet : « Vivre est une mort, et la mort elle aussi est une vie »). Qu’entendait par « source vive » Fernand Deligny en écrivant : « L’insu, voilà̀ la source vive des vraies histoires » ? Qu’est-ce qu’une parole vivante ?
Bibliographie incomplète
LACAN, La science et la vérité ; Séminaire XI ; Télévision ; Conférence de presse précédant La Troisième ; Les non-dupes errent
ARISTOTE, Parties des animaux ; Histoire des animaux ; De l’âme
BERGSON, L’Évolution créatrice
DELEUZE et GUATTARI, Mille plateaux
LAPLANCHE, Vie et Mort en psychanalyse
LÉVI-STRAUSS, Préface à la deuxième édition des Structures élémentaires de la parenté ; Entretiens avec Georges Charbonnier ; Entretiens avec Didier Éribon
DESCOLA, Par-delà nature et culture ; La Composition des mondes
VON UEXKÜLL, Mondes animaux et monde humain
LARRÈRE Catherine et Raphaël, Du bon usage de la nature, pour une philosophie de l’environnement
BOURG et SWATON, Primauté du vivant. Essai sur le pensable.
CANGUILHEM, La Connaissance de la vie
DAGOGNET, Le vivant
MERLEAU-PONTY, Causeries ; Cours sur la Nature
JACOB, La Logique du vivant
RUFFIE, Le Sexe et la Mort
PELLUCHON, Les Lumières à l’âge du vivant
LAFONTAINE, Bio-objets
DESPRET, Que diraient les animaux si…
MORIZOT, Les Diplomates : cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant
KECK, Les Sentinelles de la pandémie
LARRÈRE, Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique
STENGERS (Préface d’Émilie Hache), Résister au désastre ; L’invention des sciences modernes (avec Latour)
COLLECTIF, De l’univers clos au monde infini
HARAWAY, Vivre avec le trouble
LATOUR, Face à Gaïa ; Où suis-je ?
DE FONTENAY, Gaspard de la nuit
NANCY, Un trop humain virus
TSING, Le Champignon de la fin du monde : sur la possibilité́ de vivre dans les ruines du capitalisme
BOURSEUL, Le sexe réinventé par le genre : Une construction psychanalytique
BOURLEZ, Queer psychanalyse
ÉLIACHEFF et MASSON, La fabrique de l’enfant-transgenre
DERRIDA, séminaire 1975-1976 La vie la mort
[1] FREUD, Au-delà du principe de plaisir, dans Œuvres complètes de psychanalyse, t. XV, Paris, PUF, p. 332-333.
[2] LACAN, Les quatre concepts de la psychanalyse, Chap. 13 « démontage de la pulsion », Seuil, 1973, p. 148.
[3] Ibid., p. 150.
[4] Ibid.
[5] LACAN, Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 308.
[6] LACAN, Les non-dupes errent, 1974.
Ce colloque a ait l’objet d’une réunion du cartel Colloque le 21 juin 2021. Vous trouverez le compte rendu de la réunion ici.