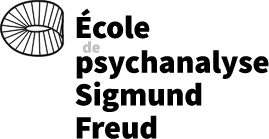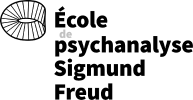Lecture collective de « L’Étourdit » de Jacques Lacan
Nous entamons la quatrième année de la lecture collective de « L’Étourdit », ce texte difficile, sinon impossible à lire dans la solitude, que Lacan écrivit comme contribution au 50e anniversaire de l’hôpital Henri Rousselle, en juillet 1972, soit dans la suite du séminaire « Ou pire ». Il a été publié en 1973 dans le n° 4 de Scilicet, puis en 2001 dans Autres Écrits.
L’Étourdit se situe au joint d’une articulation essentielle de l’enseignement de Lacan, précédé par la mise en mathèmes des quatre discours de « Radiophonie » et précédant le grand chambardement borroméen des Non-dupes errent. Mais il fait aussi le point sur les arrêtes de cet enseignement et les révèle, à la veille d’Encore, éclairant du même geste à la fois la question des discours et celle du non-rapport sexuel, non sans réouvrir à leur propos le champ de la topologie des surfaces.
Nous avons avancé la lecture jusqu’à la page 35 de Scilicet 4 (Autres Écrits, p. 469). En deux pages d’une grande densité, Lacan condense sa topologie par une monstration étourdissante. Il transforme le tore, par une succession d’opérations, en une bande de Moebius « fausse », puis, par coupure, en une bande bilatère à deux boucles, puis, par recollement le long de cette ligne de coupure, en bande de Moebius vraie. Est montré par-là que la bande de Moebius n’est qu’une coupure. Une coupure qui fait sujet, sujet d’un dire. Par contre, le dit est une coupure qui se ferme en revenant à son point de départ. On voit que la monstration topologique, dont le dessin est absent, permet à Lacan d’éclairer la structure topologique de la grammaire de ses premières phrases sur le dit et le dire. Il écrit ce qu’il démontre en écrivant. Dans « L’Étourdit », le mouvement de la phrase, se retournant sur elle-même pour se boucler, réalise la torsion de la bande de Moebius, et opère la monstration de la structure topologique du discours.
Poursuivons. En supplémentant la surface, la bande peut devenir un cross-cap, c’est-à-dire une asphère. Nous sommes ainsi passés du tore de la névrose à la rondelle de l’objet a, soit à ce qui fait l’objet de l’interprétation analytique. Mais quel enjeu donner à cette topologie par rapport au Discours analytique ? D’abord, de nous arracher à la représentation imaginaire du monde comme sphérique et à l’idée même d’univers. Ensuite, d’articuler dans ce n’espace, espace non sphérique, comment la structure, c’est le réel qui se fait jour dans le langage. Dans les pages qui suivent, Lacan rappelle que le discours est un lien social et que le Discours analytique vise à fonder un groupe nettoyé de tout imaginaire. C’est le pari de son École, fondée sur le réel du groupe analytique. La topologie n’est ni métaphore ni théorie, elle est un dire, un dire tenant la place du Réel. Mais il ne s’agit ni du réel de la mathématique (dont la topologie est une branche), ni de celui que vise le discours scientifique, mais du Réel propre au Discours analytique : le défaut de l’univers, l’impossible du rapport sexuel. « La topologie doit rendre compte de ce que, coupures du discours, il y en a de telles qu’elles modifient la structure qu’il accueille d’origine. »
Déplier ensemble à la fois l’architecture conceptuelle de Lacan et sa syntaxe que la complexité, bien qu’impeccable, peut parfois rendre opaque, est un travail qui ne cesse de remplir d’étonnement ceux qui s’y prêtent.
Dates
- mercredi 01 octobre 2025 à 20:30
- mercredi 05 novembre 2025 à 20:30
- mercredi 03 décembre 2025 à 20:30
- mercredi 07 janvier 2026 à 20:30
- mercredi 04 février 2026 à 20:30
- dimanche 01 mars 2026 à 20:30
- mercredi 06 mai 2026 à 20:30
- mercredi 03 juin 2026 à 20:30